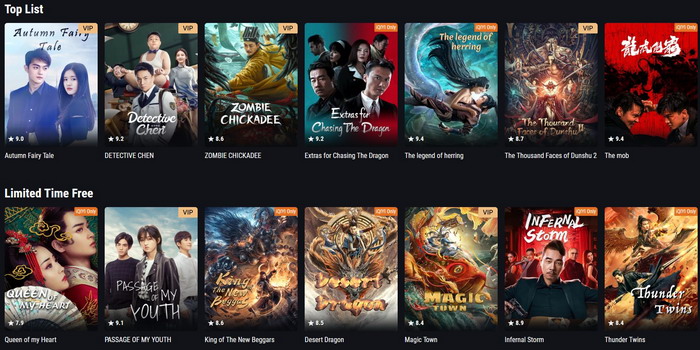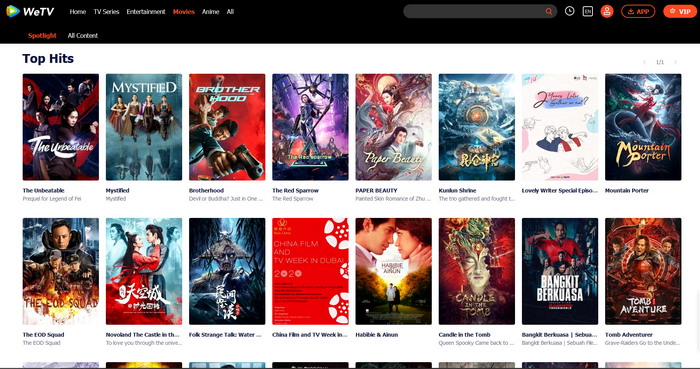« Le Ed Wood chinois », « le réalisateur le plus nul n’ayant jamais sévi à Hong-Kong » … Voilà par quels sobriquets certaines plumes, pourtant avisées, ont résumé la carrière de celui que l’on nommera selon les métrages et les postes occupés Lam Nam-Choi, Lam Ngai-kai, Simon Lam ou encore Lan Nei Tsai. De fait, nous tenterons à travers ces modestes lignes de démontrer que rien n’est moins vrai et que derrière le bis assumé de ses travaux se cache l’œuvre d’un homme torturé, politisé mais, surtout, éminemment amoureux du septième art le plus inventif et audacieux. Exploitant à son paroxysme toutes les potentialités d’une industrie hongkongaise déjà diablement rompue aux propositions foutraques, notre homme repoussera les limites du « portnawak » jusqu’ à ses plus ultimes retranchements, faisant de sa filmographie l’un des manifestes les plus jouissifs et créatifs de la folie décomplexée d’un cinéma ne s’interdisant aucune outrance, pressé par l’horloge d’une situation politique proche de sonner l’heure fatidique. Bienvenue dans l’univers kitsch et coloré du maître incontesté du bis asiatique.

Un artiste mystérieux
Notre homme est discret et l’on sait très peu de choses sur sa personne, ses idées et le sens de ses choix cinématographiques. Peu bavard, n’ayant donné que très peu d’interviews, la conjecture et les hypothèses sont de mises lorsque l’on tente de comprendre qui se cache derrière le cinéma outrancier et généreux du réalisateur. Les informations le concernant filtrent si peu qu’il est même difficile d’établir avec certitude sa date de naissance. Si la plupart des sources mentionnent l’année 1953 d’autres, plus récentes, s’appuient sur des déclarations floues de l’intéressé sur les réseaux sociaux chinois (Sina Weibo), pour avancer la date du 18 septembre 1951.
Quoiqu’il en soit, Lam Nai-Choi est né à Hong Kong, sa famille quittant la ville pour s’installer à Tai Po Tsai, territoire rural, lorsqu’il atteint l’âge de cinq ans. Après des études à l’école navale de Hong Kong, il parvient à se faire embaucher par le mythique et prolifique studio Shaw Brothers à l’âge de quinze ans. Officiant au départ comme « garçon de plateau », à savoir celui qui déplace et branche les machines et passe le balai en fin de journée (il en obtiendra d’ailleurs son surnom de Lam Ngai-kai, soit Lam « la souris », capable de se faufiler dans n’importe quel recoin du studio), il monte peu à peu les échelons, appréhendant par ce biais les différentes tâches propres à la confection d’un film. C’est le directeur de la photographie japonais Tadashi Nishimoto (1921-1997), davantage connu sous le nom de He Lan Shan, qui le prend sous son aile et lui inculque les bases du métier. L’homme n’est pas n’importe qui. Il est en effet le développeur du légendaire Shawscope qu’il introduira auprès des réalisateurs du studio, notamment Lin Han Hsiang et King Hu (pour qui il travaillera, entre autres, sur L’Hirondelle d’Or). La carrière de Lam démarre donc sous les meilleurs auspices et, chemin faisant, il devient l’un des tous meilleurs directeurs de la photographie de la Shaw, collaborant avec Wong Fung, Hua Shan, Chor Yuen mais surtout Sun Chung (lui-même grand innovateur au sein de la firme, étant le premier à y utiliser la steadycam et précurseur d’un montage davantage énergique et nerveux). Lam finira par devenir son directeur de la photographie attitré, officiant sur plusieurs de ses métrages, qu’il s’agisse de polars, de comédies aux ambiances contemporaines, ou de wu xia pian (film de sabre chinois) et autres films de kung-fu, dont le culte et sublime The Avenging Eagle, scénarisé par le non moins fameux Ni Kuang (Un Seul Bras Les Tua Tous, La 36eme Chambre de Shaolin, Martial Club…), homme on ne peut plus important pour notre sujet, comme nous allons le voir. Si la photographie de Lam Nai-Choi, respectant fidèlement le cahier des charges formel des productions Shaw Brothers, ne possède pas vraiment de touche spécifique, il va sans dire que le travail est généralement appliqué et expert. Lam sait visiblement jouer sur les tons et les ombres afin de donner à ses travaux des atmosphères marquantes, sublimant les plans innovants de son mentor, dont il suivra l’exemple sur ses premières réalisations. L’homme n’est pas manchot, notons-le, et il fait ses classes avec des artisans de premier ordre, aux travaux parfois même visionnaires.
Au début des années 80, la Shaw Brothers est vieillissante et tente le renouveau en invitant de nouveaux talents à passer derrière la caméra. Ce faisant, elle charge Danny Lee (ayant par la suite réalisé quelques métrages mais étant essentiellement connu pour ses rôles de flics ou de gangsters dans des métrages tels que The Killer, Just Heroes ou City on Fire) de réaliser un film scénarisé par Wong Jing, éminent personnage dans la carrière de Lam Nai-Choi, devenant d’ailleurs l’un des tauliers de l’industrie locale quelques années plus tard. Inséparable de Lam, Lee le convainc, malgré ses réticences, de co-réaliser ce projet avec lui. En 1981, sort donc One Way Only, comédie quelque peu insipide sur fond de courses motorisées dans laquelle le style si reconnaissable de notre artiste atypique n’est pas encore même en gestation. Cependant, l’expérience semble lui plaire et Lam se met alors en tête de poursuivre l’aventure en montant la société Heroes Films avec son binôme et de s’atteler à la production de films plus ambitieux, toujours sous l’égide de la Shaw Brothers.


One Way Only (1981)
Entre aspirations auteurisantes et tentations bis
Les deux premières réalisations de Lam Nai-Choi, à savoir Brothers From the Walled City (1982) et Men From The Gutter (1983) détonnent fortement du reste de sa filmographie. Bien qu’étant des commandes de la Shaw Brothers scénarisées par les équipes internes du studio, les deux métrages s’inscrivent pleinement dans le travail de la Nouvelle Vague hongkongaise (Tsui Hark, Patrick Tam, Ann Hui, Kirk Wong…) alors en plein essor. Tournés en extérieur, à même la métropole et ses ambiances parfois sordides à l’époque, ces films, bien que dirigés vers l’action, sont des œuvres sociales, sombres et désespérées. La photographie crue et les choix colorimétriques volontairement ternes de Lam renforcent encore l’ambiance glaçante de cette jungle urbaine en décomposition. Brothers From The Walled City nous introduit tout d’abord au sein les ruelles labyrinthiques de la défunte Kowloon City. Sous l’égide de la légendaire productrice Mona Fong, Lam signe certainement l’un de ses métrages les plus noirs (son préféré, selon ses propres aveux), loin de la fantaisie généreuse dont il se fera le chantre quelques années plus tard. Pauvreté, criminalité, famille dysfonctionnelle, avortement, corruption, violences policières, toxicomanie… un ensemble de thèmes brassés par une mise en scène et une photo minimaliste, allant droit à l’essentiel. Chin Siu Ho, devenant par la suite un habitué des films de « la souris », campe ici un personnage touchant et convaincant. Sans détours, par la manière dont il filme la ville et ses interactions humaines, le réalisateur donne les bases à une flopée de réalisateurs ultérieurs, dont le grand Ringo Lam, en livrant une oeuvre au réalisme froid, faisant de la cité emmurée et ses tentacules un piège où le pire est toujours à venir. Quant au second, Men From The Gutter plonge le spectateur dans un chassé-croisé où flics violents, braqueurs à la petite semaine et gangster en quête de vengeance tentent tous vainement de fuir une ville qui n’a plus que la douleur et la perdition à offrir. On ne fuit pas de Hong Kong dans les films de Lam. On y souffre et on y meurt. Épaulé par les grands Yuen Bun (Sword Master, Kung-Fu Killer, Swordsman 2, Green Snake…) et Yuen Wah (Le Flic de Hong-Kong, Black Lizard, Eastern Condors…) à la direction de l’action, il signe ici un polar maîtrisé, à la mise en scène audacieuse et millimétrée, culminant dans un climax de folie faisant sûrement parti de ce qui se fit de mieux dans le genre, participant à fonder le polar « hardboiled » et influençant des œuvres comme On The Run (Alfred Cheung, 1988) ou Long Arm Of The Law (Johnny Mak, 1984). Toutefois, quelques fulgurances bis se font déjà sentir ici ou là. Si le ton est résolument sérieux, notre homme, souhaitant avant tout en mettre plein la vue au spectateur, se laisse parfois aller à une exagération dans la mise en scène et les situations, frisant alors le burlesque ou le gore qui tâche, donnant à ces deux premiers jalons une saveur particulière, marquant de fait son territoire et un imaginaire très personnel. Si Lam Nai-Choi n’est pas encore l’empereur du bis foutraque, il prouve ici qu’il est un réalisateur maîtrisant son sujet, formé auprès des meilleurs et démontrant un savoir faire indéniable. Men From The Gutter recevra d’ailleurs un bel accueil critique, remportant même le prix du montage lors du 28e Festival du Film de Taipei.

Brothers From The Walled City (1982)

Men From The Gutter (1983)
En revanche, cette tentation « nanardesque » ne le quittera plus et s’accentuera et ce, même lorsqu’il reviendra à des métrages plus sérieux, tels que Killer’s Nocturne (1987) et Her Vengeance (1988). Si le premier est une sombre histoire de vengeance sur fond de gambling (l’intrigue se joue autour de parties de mah-jong), Lam n’hésite pas une seconde à nous proposer un splendide combat entre Chin Siu Ho et un kangourou (oui vous avez bien lu) lorsque, dans le second, un rape and revenge cruel et sordide frisant la catégorie III (catégorie IIB), il nous offre une séquence hallucinante avec un Lam Ching-Ying faisant des acrobaties martiales en fauteuil roulant sur le toit d’un building. Dans ces deux films, les climax se placent sous le signe du surréalisme et du fun le plus inventif, rivalisant de scènes gores et de pièges dignes d’un Rambo ou d’un Schwarzie en pleine jungle, annonçant déjà les délires sanglants d’un The Story of Riki-Oh (1991), film culte au sein duquel les protagonistes, enfermés dans une prison futuriste, s’éviscèrent, s’arrachent les yeux et les entrailles dans un gore jusqu’au-boutiste confinant volontairement à l’absurde et au burlesque.

Killer’s Nocturne (1987)

Her Vengeance (1988)
Le grand saut assumé vers le bis qui tâche est de toute façon franchi depuis The Ghost Snatchers (1986), soit le film du début de la réelle collaboration avec Wong Jing, avec qui il fonde Dalu Film Production en 1988, accompagnant ainsi son transfert à la Golden Harvest, firme productrice de tous les métrages à venir. Wong Jing est cette fois-ci au scénario mais aussi au casting et Yuen Bun encore à la direction de l’action. Lam signe un film délibérément cinglé, se permettant toutes les audaces et autres délicieuses incongruités : TV vivante et gloutonne, fantômes coquines, squelettes mangeurs d’hommes, blagues paillardes et absurdes. Un régal. Très influencé par les succès US de l’époque (Ghostbusters, Poltergeist, Videodrome, Zombie…) et reprenant à son compte quelques codes de la Ghost Kung-Fu Comedy (sutras salvateurs, humour cantonais, rupture de tons), The Ghost Snatchers est un véritable festival de séquences inédites et siphonnées, ne reculant devant aucune absurdité pour contenter son public. Un goût certain pour les SFX artisanaux, ici réalisés par Ng Kwok Wa (officiant sur des productions « Wong Jing » telles que Magic Crystal ou City Hunter), fleure bon l’amour du cinéma de Ray Harryhausen et consorts. Et Lam se prend au jeu. Cette imagerie délectablement kitsch habitera dès lors la plupart de ces travaux, pour le plus grand plaisir de tous les cinéphiles déviants. Une question se pose toutefois : pourquoi un tel virage ? Si la rencontre avec Wong Jing joue très certainement son rôle, d’autres hypothèses peuvent être avancées.


The Ghost Snatchers (1986)
En effet, Wong Jing, dont les considérations commerciales en matière de création ne sont un secret pour personne, a dû sans aucun doute insister auprès de notre réalisateur pour qu’il planche sur des œuvres moins sombres et viscérales, davantage susceptibles de divertir un public en quête d’amusement et de sensations fortes. Un seul mot d’ordre anime alors sa carrière : offrir à son audience du « jamais vu ». Si cela est vrai (et nous le pensons), il reste à déterminer pourquoi ces conseils ont eu un tel écho dans la vision artistique de Lam. Plusieurs pistes constituent, à notre humble avis, quelques éléments de réponse. Premièrement, les deux premières bobines réalisées n’ont sûrement pas eu pour Lam le résultat commercial escompté, n’avoisinant que difficilement les trois millions de dollars HK de recettes. Le choix de se tourner vers des histoires plus légères – ou d’opter pour une truculente outrance décomplexée – trouve donc aussi son explication ici : Lam Nai-Choi veut un succès pour, comme nous le verrons, des raisons aussi professionnelles que personnelles. Deuxièmement, c’est la rencontre – ou l’approfondissement du travail mutuel – avec Ni Kuang, écrivain de nouvelles pulps et serialesques, mais aussi celles avec quelques piliers du tokusatsu (film à sfx nippon) qui vont déterminer, et même renforcer, la direction prise par ce dernier.
Le Japon, terre d’innovation
L’opus suivant, réalisé dans la foulée, poursuit le travail amorcé avec The Ghost Snatchers. Pour The Seventh Curse (1986), le curseur de la folie est poussé encore plus loin. Le but est clairement de marquer la rétine et l’imaginaire du spectateur. Réunissant un casting impressionnant (Chin Siu Ho, Chow Yun Fat, Maggie Cheung, Dick Wei, Yasuaki Kurata…), le film se veut un hommage aux films horrifiques de la Shaw Brothers des années 70, déroulant souvent des scenarii portées vers la sorcellerie et le folklore de l’Asie du Sud-Est. Un peu de de Spirit of the Raped, de The Boxer’s Omen (Kuei Chih-hung, 1976, 1983) ou de The Black Magic 2 (Ho Meng-hua, 1976), une grosse dose d’Indiana Jones et quelques pincées d’Evil Dead (Sam Raimi, 1981) et le tour est joué. Le métrage fait dans la démesure à tous les niveaux. Grâce à une photographie maitrisée (les critiques clamant que Lam ne sait pas réaliser feraient bien de revoir aussi cette bobine dans de bonnes conditions), l’audience est immergée dans une sombre -mais drôle- histoire de sorcellerie thaïlandaise et de démons assoiffés de sang. Le plaisir et la surprise sont de chaque instant : scènes de jungle, combat hallucinant sur un bouddha géant, temples souterrains, cimetières hantés, squelette aux yeux phosphorescents adepte de kung-fu, effets gores, chorégraphies martiales impeccables (assurés par Yuen Bun et Ringo Wong, le chorégraphe attitré de Tony Lu), monstrueux bébé volant mangeur d’hommes, érotisme plus ou moins diffus, sacrifice et bouillie de bébés… bienvenue dans la catégorie III de Lam Nai-Choi, s’imposant définitivement comme l’un de ses plus grands et imaginatifs représentants. Le film saura aussi séduire des maîtres comme Johnnie To. En effet, la scène introduisant le film, se déroulant lors d’une prise d’otage, n’est pas sans rappeler une séquence de Heroic Trio (1993), dans lequel jouera d’ailleurs Maggie Cheung. Le public ne s’y trompe pas. Le box-office frôle les onze millions de dollars HK, ce qui est loin d’être indigne (rappelons toutefois qu’un véritable succès à Hong Kong avoisine les 30 à 40 millions de recette). Scénarisé par le désormais inévitable Wong Jing, l’intrigue se base sur Blood Curse, nouvelle de Ni Kuang, faisant d’ailleurs un petit cameo pour l’occasion. Celui-ci a sûrement dû entrer en contact avec Lam à l’occasion de la production du Avenging Eagles de Sun Chung, comme nous l’avons vu (quoiqu’il ait scénarisé plusieurs métrages de Sun Chung comme, par exemple, Le Professeur de Kung-fu). Auteur de plus de 300 romans et d’environ 400 scenarii, essentiellement du wu xia pian et de la science-fiction, Ni Kuang est aussi le créateur des aventures du Dr. Yuen, médecin et aventurier (ici campé par Chow Yun Fat) ayant plus de trente romans au compteur. Cette collaboration ne sera d’ailleurs pas sans suite puisque Lam adaptera aussi les aventures du justicier milliardaire Wisely – lui aussi héros de plus de 130 ouvrages de l’écrivain et partageant le même univers que le Dr. Yuen – pour son ultime – et plus célèbre – métrage, à savoir The Cat (1992), contenant la cultissime séquence du combat d’arts martiaux en mode Yuen Woo-Ping (basé sur «la danse autour de l’objet», genre chorégraphique utilisant les objets et meubles présents autour des combattants) entre un chat noir et un molosse.


The Seventh Curse (1986)
Autre fait important : les effets spéciaux. Si l’on a souvent – et bien vite – raillé le kitch, voir la nullité, des sfx des films de Lam, ceux-ci, bien que dégageant le charme suranné mais intemporel des effets spéciaux « maison » et artisanaux, sont loin d’être aussi navrants. Ils n’ont même rien à envier (dans tous les cas sur The Seventh Curse et quelques autres) à plusieurs productions hollywoodiennes, pourtant bien moins fauchées, de la même période (Les Aventures de Jack Burton dans les griffes du Mandarin, Explorers…). S’il en est ainsi, c’est aussi parce que Lam sait s’entourer. Sûrement conseillé par Ni Kuang qui avait préalablement travaillé avec lui sur Le Colosse de Hong-Kong (Ho Meng-hua, 1977), le réalisateur fait appel à l’un des experts du tokusatsu, Keizo Murase, responsable des sfx sur une flopée de films et séries (Kamen Rider, Ultraman Ace, Godzilla vs Mothra, Godzilla vs King Ghidorah, Gamera…). Le choix opéré par Lam de se tourner vers les experts japonais n’est pas anodin : il partage avec ces derniers l’amour des trucages artisanaux et ingénieux, se moquant d’un réalisme forcené, absurde, souvent froid et aseptisé. S’appuyant sur ce qui se fait de mieux dans le genre, ce rapprochement est le signe d’un artiste sachant où il va et avec qui il souhaite collaborer, démontrant une connaissance approfondie des talents, genres et tendances ayant cours en Asie à cette époque. La décision s’avère judicieuse. En effet, The Seventh Curse passe ainsi les frontières nipponnes, devenant même dans l’archipel un relatif succès en se payant le luxe d’être le seul film hongkongais présent au Festival du Film de Science-Fiction de Tokyo en 1986.
Il est vrai que les films de Lam sur lesquels les effets spéciaux sont pris en charge par des hongkongais sont indéniablement moins bien exécutés à ce niveau. Mentionnons le très mineur Erotic Ghost Story (1990), bobine au sfx épouvantables, n’ayant d’ailleurs d’intérêt que pour sa photographie renvoyant aux grandes heures de la Shaw Brothers et parce qu’elle lancera la tendance des wu xia pian lubriques de catégorie III tels que la saga des Sex and Zen. Ajoutons aussi le violentissime The Story of Ricky (1992) qui, malgré d’autres indéniables qualités, ne convainc pas toujours en la matière. Le film est d’ailleurs basé sur une œuvre japonaise, à savoir le manga Riki-Oh (Tetsuya Surawatari, Masahiko Takajo)

Erotic Ghost Story (1990)
Toutefois, la collaboration avec les japonais ne s’arrête pas à The Seventh Curse. Pour La Légende du Phoenix (1988) et sa suite, beaucoup moins réussie, La Saga du Phoenix (1989), ce ne sont pas moins que deux autres légendes du tokusatsu qui sont conviés à élaborer des sfx du plus bel acabit : Keita Amemiya (Moon Over Tao, Kamen Rider ZO, Mechanical Violator Hakaider, Garo…) et Shinji Higuchi (Shin Godzilla, Shin Ultraman, L’Attaque des Titans…). Mentionnons d’ailleurs, pour l’anecdote, que le célèbre réalisateur Takashi Miike, visiblement influencé par Lam si l’on en juge le reste de sa filmographie parfois borderline et bordélique (Ichi The Killer, Zebraman…), officie en tant que réalisateur de seconde équipe sur les deux métrages. Egalement construits autour d’un manga (Kujaku-Ô de Makoto Ogino), les deux bobines proposent leur lots de scènes et d’inventions marquantes. Nous y suivons les aventures de deux moines, l’un chinois (Yuen Biao), l’autre japonais (Hiroshi Mikami), parcourant l’Asie afin d’éviter le réveil d’un démon et donc, de la fin du monde. Wu xia pian (genre peu abordé par notre homme) fantaisiste convoquant plusieurs autres grandes figures du genre (Gordon Liu, Eddy Ko…) et définitivement tourné, malgré quelques fulgurances sanglantes, vers un public davantage familial, La Légende du Phoenix est une réussite et un délire visuel inédit. Décors ambitieux, monstres et créatures en tout genre, stop-motion, animatroniques, pyrotechnie, incrustations… Keita Amemiya impose sa touche si personnelle, toujours très influencée par H.R Giger, et propose un spectacle de haute tenue. Lam s’implique visiblement et vise sans aucun doute le sommet du box-office (le film semble être doté d’un budget assez conséquent pour l’industrie hongkongaise). Concernant l’action, c’est le génial Phillip « hardboiled » Kwok qui s’en charge. Ce dernier assurera d’ailleurs la même fonction sur les productions à venir, à savoir The Story of Ricky et The Cat. Malheureusement, le succès est très relatif, la barre fatidique des onze millions n’étant toujours pas atteinte. Ce n’est d’ailleurs pas sa suite, La Saga du Phoenix, qui changera la donne. Bien que réunissant la même équipe que le premier volet et constitué de plusieurs morceaux de bravoure technique, le métrage, malgré la présence du grand Shintaro Katsu au casting, visant la très jeune enfance, alors enthousiasmée par des succès tels que Gremlins (19i84) ou Les Goonies (1985), ne parvient jamais à décoller et s’embourbe dans une suite de scènettes burlesques assez pitoyables, mettant en image les chamailleries ineptes de Shek Yin Liau (Operation Scorpio, Une Balle Dans la Tête…) et d’un petit monstre renvoyant à Guizmo, mais en mode crado.


La Légende du Phoenix (1988)


La Saga du Phoenix (1989)
Fait intéressant concernant The Cat et ponctuant l’aventure japonaise de Lam, c’est Shinji Higuchi, quoique non crédité, qui en assure une bonne part de la réalisation. En effet, un chat trouvera la mort sur le tournage, provoquant l’ire du producteur Lam Chua qui, excédé, congédiera sans autre forme de procès Lam Nam-Choi. Higuchi, seul présent sur le plateau à pouvoir le remplacer au pied levé, assurera alors l’intérim et terminera le tournage de ce film entré depuis au panthéon du bis. Cette ultime œuvre de Lam, comédie fantastique narrant les tribulations d’une bande d’aliens échoués sur Terre dont le général a pris la forme terrestre d’un chat noir ayant maille à partir avec une créature blobesque et un ersatz de Terminator des plus cruels, est des plus importantes. Si elle a indéniablement influencé le réalisateur indien S.S Rajamouli pour son Eega (2012), dans lequel le personnage principal est réincarné en mouche, c’est aussi celle dans la laquelle, pour la première fois, Lam Nai-Choi aborde explicitement un sujet dont l’ombre plane sur l’intégralité de sa filmographie : la peur de 1997.
Fuir avant la rétrocession
En effet, 1997 est plusieurs fois mentionné dans The Cat. Par exemple, lorsque la dulcinée de Wisely (interprété par Waise Lee, ça ne s’invente pas), héros de l’histoire, lui demande pourquoi il dort si peu, celui-ci lui répond : « Napoléon dormait quatre heures par nuit et cela aurait sûrement été moins s’il avait su que 1997 arriverait ». Plusieurs phrases de ce type émaillent la bobine, présentant Hong Kong comme une terre vouée à un destin funeste, où les choses ne seront bientôt plus jamais les mêmes. 1997 est, il est vrai, tout un symbole pour les hongkongais. C’est l’année de la rétrocession de leur pays, passant alors des mains britanniques à celles de la Chine Continentale et de son intransigeant Parti Communiste. Les négociations ont débuté au début des années 80, soit en même temps que la carrière de Lam en tant que réalisateur.
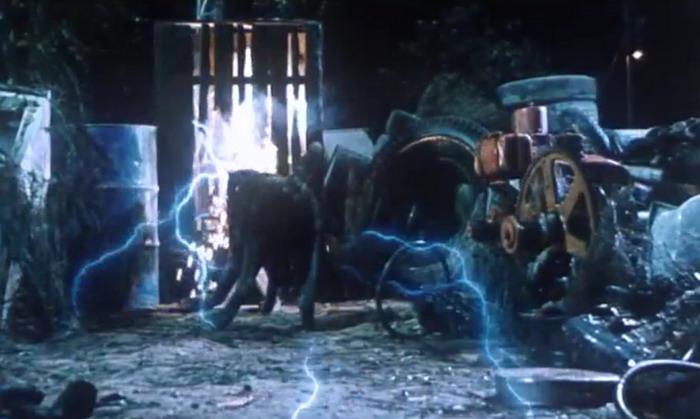

The Cat (1992)
Ici, la personnalité de son ami, le romancier Ni Kuang, signant comme on l’a vu les œuvres ayant donné naissance à The Seventh Curse et The Cat, prend toute sa place. Né en Chine en 1935 (il décède en 2022), il fut chargé de rédiger les condamnations à mort du régime dans les années 50 et connut donc dans son intimité les horreurs de la dictature maoïste. Parvenant à fuir le continent en 1957 pour s’installer à Hong Kong, il demeurera un anti-communiste forcené tout au long de sa vie, infusant ses idées politiques au sein de ces romans, à première vue de simples récits d’aventures et de science-fiction. En 1992, soit l’année de la sortie de The Cat, celui-ci quittera l’Asie pour les États-Unis afin de ne pas avoir à subir les changements opérés lors de la prise en main -« de fer »- continentale. Il n’est pas fortuit que la carrière de Lam Nai-Choi se stoppe exactement à ce moment-là… et qu’il quitte lui aussi le territoire quelques temps plus tard pour San Francisco, mettant un terme à sa carrière filmique par la même occasion. Installé aux Etats-Unis, puis vraisemblablement en Europe, l’homme s’est investi dans des causes humanitaires, revenant parfois au pays pour travailler en tant que bénévole dans des orphelinats ou participer à des programmes de lutte contre la pauvreté. Du cinéma, il ne veut plus en parler et semble en avoir fait le deuil, préférant parcourir le monde et offrir au public ses photographies de voyage à travers ses réseaux sociaux.

Ni Kuang
Une carrière brève, atypique, mais influente
Lam n’attendit donc pas de voir ce que 1997 offrirait. Il a préféré passer son tour … et passer à autre chose. Toute sa carrière démontre qu’il ne pouvait en être autrement. Des films de ses débuts (Brothers From the Walled City, Men From the Gutter), dépeignant Hong Kong avec un pessimisme et une noirceur extrême, faisant de la métropole une prison à ciel ouvert dont on ne peut s’échapper à ses productions plus légères et « watzefuk », l’ombre de la menace communiste et continentale est toujours présente. Qu’il s’agisse d’extra-terrestres (The Cat), de démons (La Légende du Phoenix), de systèmes totalitaires (The story of Ricky) ou de criminels prédateurs (Her Vengeance), les hongkongais y sont toujours confrontés à une menace extérieure voulant à tout prix prendre le contrôle sur leur façon de vivre et mettre à mal leur existence. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si la région où l’intrigue de La légende du Phoenix prend place ressemble fortement au Tibet, soit une façon pour le réalisateur d’exprimer sa sympathie envers un peuple qui, lui aussi, doit souffrir de l’autoritarisme des autorités chinoises. Dans cette situation, faire des films est pour Lam un acte de résistance. Ses « errances » de plus en plus bis, ses « nanars » tordus, ont aussi un objectif politique : se permettre un dernier baroud d’honneur, mettre en avant tout ce qu’il sera, selon lui, à tort ou à raison, impossible de faire sous l’égide communiste. Du sang, de la violence, du sexe, du fantastique, soit tout ce que le Parti maoïste a toujours abhorré. C’est aussi, nous semble-t-il, pour cette raison que ses derniers travaux, de loin les plus fous, sont aussi les moins appliqués. Au diable les faux raccords et une mise en scène élaborée ! Donnons à Hong Kong ce qu’il ne pourra bientôt plus regarder ! Que ce soit la revisite « pornographique » de l’histoire chinoise (Erotic Ghost Story) ou la véritable boucherie grand-guignolesque (The Story of Ricky) en passant par les histoires surnaturelles honnies par les communistes (The Cat), Lam crie sa rage, sa douleur et sa peur de l’avenir, mais aussi son mépris pour un gouvernement dont il ne veut pas avoir à souffrir les règles dans son propre pays. Créer, c’est aussi résister, et l’on peut dire que Lam Nai-Choi a su le faire avec panache et créativité, influençant sur quelques treize films une flopée de réalisateurs et de courants (Ringo Lam, Alfred Cheung, Johnny Mak, S.S Rajamouli, Takashi Miike, la catégorie III…). Chapeau l’artiste.


The Story of Ricky (1992)
Pour finir, nous ne saurions que trop vous conseiller, en guise d’excellent complément à cette lecture, l’écoute du podcast La 36eme Chambre du Cinéphage consacré à notre homme, auquel nous avons d’ailleurs eu l’honneur de participer.
Paul Gaussem.
-
- Introduction
- Un artiste mystérieux
- Entre aspirations auteurisantes et tentations bis
- Le Japon, terre d’innovation
- Fuir avant la rétrocession
- Une carrière brève, atypique, mais influente



![[JV] Ghostwire: Tokyo (2022 – Playstation 5)](https://www.darksidereviews.com/wp-content/uploads/2025/03/Ghostwire_-Tokyo_20250113082822-680x340.jpg)
![[Film] Lethal Panther 2, de Cindy Chow Fung (1993)](https://www.darksidereviews.com/wp-content/uploads/2025/06/lethalpanther2-680x340.jpg)
![[Portrait] Qin Peng-Fei, le meilleur de l’action chinoise ?](https://www.darksidereviews.com/wp-content/uploads/2025/04/QinPengFei-680x340.jpg)
![[Interview] Mickaël Dusa et Jolan Nihilo (réalisateurs)](https://www.darksidereviews.com/wp-content/uploads/2023/11/Mickael-Dusa-Jolan-Nihilo-680x340.jpg)




![[Film] Running Out of Time 2, de Johnnie To et Law Wing-Cheong (2001)](https://www.darksidereviews.com/wp-content/uploads/2022/06/root2-680x340.jpg)
![[News] Les Sorties Spectrum Films de Juin](https://www.darksidereviews.com/wp-content/uploads/2024/09/Spectrum-Logo.jpg)
![[Film] Exquisite Bodyguards, de Yuan Guang-An et Meng Zhen (2023)](https://www.darksidereviews.com/wp-content/uploads/2025/06/exquisitebodyguard-680x340.jpg)